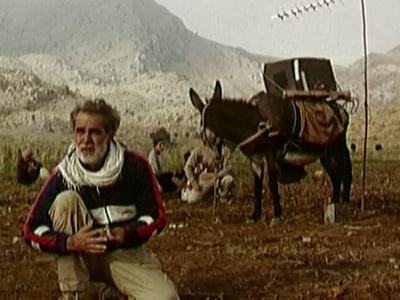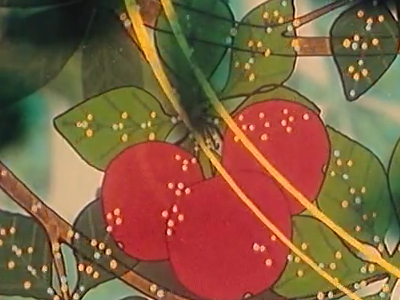Classes multicolores V : Classes à la ferme
2003-0114 : Classes multicolores V : Classes à la ferme, un film de Marc Dallon (2003, 20′)En 2003, les classes multicolores offrent aux élèves une expérience inhabituelle dans un environnement vivant, riche en émotions qui s’inscrit dans un projet pédagogique. Elles permettent aux enseignants de découvrir chez leurs élèves des qualités, des compétences et potentialités qui ne se révèlent pas forcément en classe. Ici, la ferme de la Rochette sert de décor à plusieurs séjours de classes différentes à des … Lire la suite