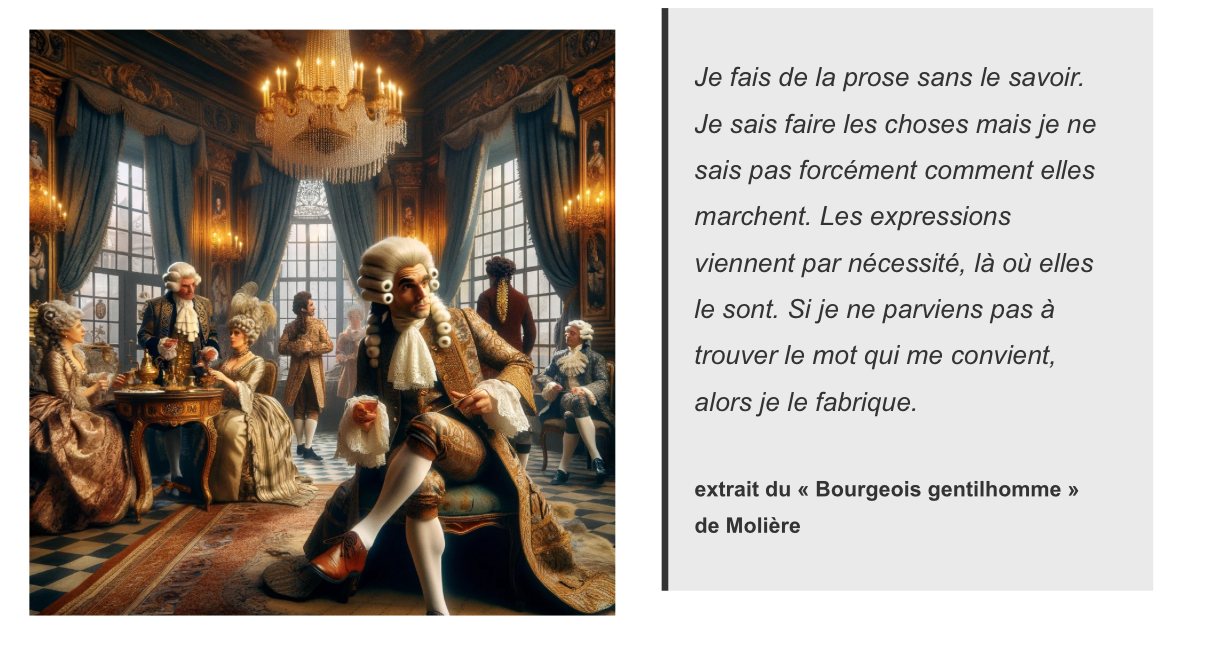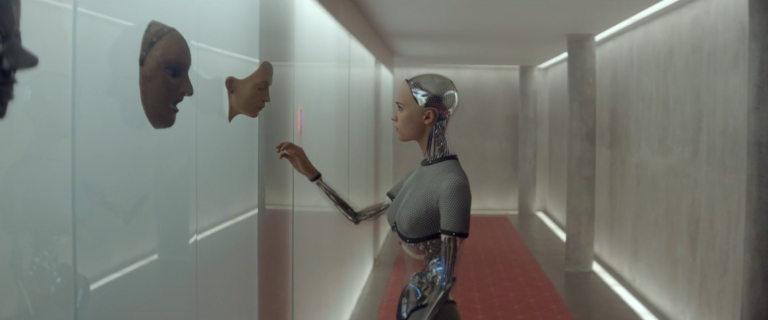Les jeux vidéo diminuent-ils les capacités d’apprentissage? Augmentent-ils l’agressivité chez les jeunes? Favorisent-ils certaines compétences? Y a-t-il un temps ou un type de jeu idéal?
Ces questions, et d’autres, étaient au centre d’un entretien, le mercredi 20 mars, avec Sylvie Denkinger et Benoit Bediou, chercheuse et chercheur de l’Université de Genève.
Cette rencontre interactive de 90 minutes a été enregistrée et nous vous proposons de l’écouter ci-dessous en rediffusion:
A propos de Sylvie Denkinger et Benoit BediouSylvie Denkinger est doctorante au Brain & Learning Lab de l’UNIGE. Sa thèse vise à découvrir les mécanismes des jeux vidéo qui sont importants pour favoriser un meilleur contrôle de l’attention.
Benoît Bediou travaille également au Brain & Learning Lab. Il s’intéresse à l’impact des médias, en particulier des jeux vidéo d’action, mais aussi des médias multitâches, sur les compétences cognitives et émotionnelles.
Crédits image: image réalisée avec DALL-E le 28 mars 2024.