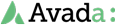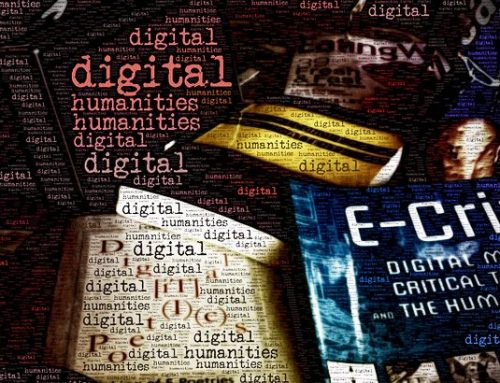(…) Personnage volubile, attentif, amical et irascible, il s’était ces vingt dernières années consacré à la réflexion sur l’emprise des technologies numériques sur nos vies et la société, après s’être imposé sur la scène intellectuelle française, dès le milieu des années 1980, puis avec sa thèse avec Jacques Derrida en 1993, comme un penseur majeur de la technique.(…)
L'article dans le Temps (août 2020)
Il y aurait beaucoup à dire de lui, ainsi que de nombreux textes à consulter. Deux interviews ont été retenues ici, en voici des extraits…
« L’Ecole de demain. Entretien avec Bernard Stiegler »
Stiegler Bernard, Grygielewicz Malgorzata, Périn Nathalie, « L’École de demain », Rue Descartes, 2020/1 (N° 97), p. 119-135. DOI : 10.3917/rdes.097.0119.
L'article
Il en résulte qu’aujourd’hui s’impose dans le contexte « postvéridique » un sentiment sinon de vanité, du moins d’inefficience, de discrédit et de malaise fondamental dans le système académique, à l’école, au collège et au lycée comme à l’université.
J’ai essayé de montrer dans différents textes que ce malaise est d’abord engendré par un état de fait tel que les industries de programme (audiovisuels aussi bien qu’algorithmiques) sont entrées en concurrence avec les institutions de programme qui forment le système académique, ce qui fait que, d’une part, les enfants n’ont plus la disponibilité attentionnelle requise pour être à l’écoute, et, d’autre part, mais c’est moins communément admis – et c’est évidemment difficile à dire et à faire admettre –, les enseignants sont eux-mêmes massivement affectés par cette concurrence. C’est tout aussi vrai des parents, et ceux-ci ne supportent pas toujours qu’on le leur dise – les parents, c’est-à-dire beaucoup d’entre nous.
Il en résulte un affaiblissement toujours accru de l’attention et en conséquence, de la responsabilité – et c’est aussi cela que dit Greta Thunberg à ses générations ascendantes, c’est-à-dire : à nous. De fait, tout le problème est que ce qui se passe dans le champ académique au sens le plus large, et lorsque, de près ou de loin, le nom de l’émission Star academy est le symptôme d’une désintégration fonctionnelle des savoirs (académiques ou non), de fait, donc, à la fin de l’ère Anthropocène, tout cela est devenu illégitime, la légitimité de l’académie s’étant dissoute sous l’effet de technologies analogiques et numériques dont la mise en œuvre est totalement soumise aux industries de programmes, cependant que l’on demande aux institutions de programmes de s’adapter toujours plus à ces industries et à leur modèles informationnels et communicationnels. (pp. 125-126)
(…) Cette situation, qui s’est installée avec le world wide web, et qui n’a été ressentie et problématisée que depuis peu – il y a moins de dix ans –, fait que dans un nombre sans cesse croissant de domaines, il est devenu presque impossible à un enseignant dans un collège ou dans un lycée de mettre en œuvre des prescriptions qui lui auraient été transmises dans sa formation académique : il s’agit de réalités qui n’existaient tout simplement pas au moment où lui-même fut enseigné, et qui font désormais l’essentieldu processus de transformation en cours, affectant les enfants et les parents comme les enseignants, et par rapport à quoi tous ceux-ci sont démunis, comme le sont le Président de la République, le Secrétaire général de l’ONU et la direction de Google. (pp. 127-128)
(…) L’école de demain doit produire non pas de bons employés adaptables à la tâche prédéfinie par un système de production massivement automatisé, mais des critiques : des travailleurs qui soient capables de critiquer l’économie pour amener l’économie à produire mieux, c’est-à-dire de manière plus économique. « Plus économique », dans l’ère anthropocène, cela veut dire : réduisant l’entropie, augmentant la néguentropie, ce qui est la fonction de tout savoir. Au moment où la disruption se mettait en place (au début des années quatre-vingt-dix), les rapports du GIEC commençaient à révéler l’extrême gravité de la situation dans la biosphère, et l’immense responsabilité qu’a le monde économique quant à la transformation de cet état de fait. Il s’agit désormais de faire en sorte que le monde économique soit capable d’augmenter son potentiel de lutte contre l’entropie et de diminuer corrélativement sa production d’entropies thermodynamiques, biologiques et informationnelles.
L’enjeu est de revaloriser les savoirs et d’engager un vaste processus de déprolétarisation – la « prolétarisation » désignant ici d’abord la perte de savoir, qui affecte désormais toutes les activités humaines, sciences comprises, dont l’état de fait était déjà l’enjeu de La Condition postmoderne comme « mise en extériorité du savoir par rapport au sachant ». Il faut que l’école apprenne à former à nouveau des producteurs sachants et savants, c’est-à-dire dotés de savoirs, et non seulement de compétences, et sachant en cela lutter contre l’entropie, collectivement, et en transformant les modèles industriels liés à la prolétarisation.
Comment préparer l’école, le collège, le lycée, l’université et les grands établissements scientifiques à lutter contre l’entropie ? Telle est la question. (pp.129-130)
« Numérique, éducation et cosmopolitisme »
Cités, 2015/3 (N° 63), p. 13-36. DOI : 10.3917/cite.063.0013.
L'article (DOI)
(Mieux vaut simplement le lire en entier tant il comporte une matière intéressante (et il m’a fallu trancher…), tant du point de vue de l’analyse de Bernard Stiegler que de la description de sa pratique en tant qu’enseignant)
(…) Le numérique est une immense transformation – au sens où immense signifie démesuré : dont on n’a pas la mesure. Cette transformation est encore presque impensée dans sa portée. Outre que nous n’avons pas le recul suffisant pour en prendre la mesure, ce moment massivement disruptif fait exploser tous les cadres de pensée – qu’il faut reconstruire, et cela demande beaucoup de temps face à un événement caractérisé par sa vitesse.(p. 13)
(…) Ces médiations techniques, qui sont la condition de la constitution d’une âme noétique, c’est-à-dire d’une « vie de l’esprit » – au sens de Hannah Arendt ou de Paul Valéry –, pour autant qu’elles sont intériorisées par le cerveau, et individuées par l’appareil psychique, c’est-à-dire singularisées, sont aujourd’hui passées entre les mains de l’économie industrielle, qui met en œuvre le numérique quasi exclusivement en fonction de ses modèles d’affaire, et à travers des acteurs en guerre économique permanente, véritables seigneurs de la guerre, tels les Big Four.(…) En termes d’amplitude démographique, Facebook est aujourd’hui ex aequo avec la Chine le second acteur planétaire en termes de relations sociales… juste après l’islam. (p. 15)
(…) Avec Ars Industrialis et pharmakon.fr, nous pensons que le numérique, précisément, est un pharmakon – un poison et un remède. Notre époque commence à en voir émerger de plus en plus clairement la toxicité. (p.16)
(…) La société industrielle du xx esiècle dite « de consommation » était basée sur le consumer capitalism qui instaure des relations entre agents économiques spécifiés tels que les producteurs et les consommateurs fonctionnellement séparés. Ces relations caractérisaient ce qu’on appelle la société de masse, ayant des industries culturelles de masse, des marchés de masse, etc. Or, à Ars Industrialis, nous considérons que ces relations consuméristes engendrent une société de prolétarisation généralisée.
Nous donnons au mot « prolétarisation » un sens élargi. Pour nous, la prolétarisation signifie la réduction des savoirs par l’expansion computationnelle des modèles industriels. Cela commence par les ouvriers, qui perdent leur savoir-faire, et cela se poursuit par les consommateurs, qui perdent leur savoir-vivre, et ce jusqu’à aujourd’hui où même les concepteurs y perdent leur savoir-conceptualiser et théoriser et les décideurs leur pouvoir de décider.
Cela a été revendiqué de manière extrêmement claire par Chris Anderson. Il dit en gros : « Exit la théorie, on n’a plus besoin de théorie », ignorant tout de ce que Kant appelait le besoin de la raison. Plus besoin de théorie, cela veut dire : plus besoin de modèles formels ; cela veut dire aussi : tout est dans les big data, dans les automates, et si l’on ne comprend pas comment ça marche, ce n’est pas grave. On en est là aujourd’hui. C’est un discours que vous trouvez dans toutes les grandes entreprises. Un discours archi-faux, c’est-à-dire absolument non-viable – et cependant c’est comme cela que ça marche en ce moment. Mais cela ne saurait durer…
Ce processus de prolétarisation a commencé avec la révolution industrielle. Nous prenons le mot « prolétarisation » au sens du Marx de 1848, mais aussi au sens de Socrate au v esiècle avant J.-C. – car nous pensons que Socrate est le premier à parler de prolétarisation quand il évoque le fait que l’extériorisation de la parole dans l’écriture fait perdre la mémoire : c’est une perte de compétence mnésique. Cela peut bien nous faire rire – jusqu’au jour où nous nous apercevons qu’avec nos smartphones, nous n’avons même plus la mémoire de notre propre numéro de téléphone. Ce propos de Socrate est repris par toutes les critiques actuelles du numérique, citant le nom de Socrate, mais en n’ayant la plupart du temps pas vraiment lu Platon.
Cependant le numérique est aussi porteur d’un processus de déprolétarisation, c’est-à-dire de reconstruction du savoir, de reprise par les sujets, de leur place en tant que sujets – comme « sujets » non seulement subissant des processus de sujétion, mais s’appropriant véritablement le dispositif. Les personnes qui développent cette possibilité sont au départ surtout issues du « logiciel libre ». Cela remonte aux années 1980. Cela passe par le Media Lab et Berkeley. Tout cela porte une utopie – « l’utopie numérique » – qui va se concrétiser de diverses manières, dont Wikipédia. Tout le monde connaît Wikipédia qui fonctionne vraiment sur cette base-là, même si nous considérons que cela ne fonctionne pas suffisamment ainsi.
Il y a une positivité fondamentale du numérique en tant qu’il est porteur d’un processus de déprolétarisation, de reconstruction des processus d’individuation psychique et collective, qui dépasse l’opposition entre production et consommation et avec elle la division industrielle du travail telle que la décrit Adam Smith. Le numérique requiert une nouvelle critique de l’économie politique, qui demeure industrielle, mais qui n’est plus basée sur la prolétarisation. C’est cette espèce de ré-enchantement du monde industriel que nous avons décrit dans un ouvrage publié en 2008.
L’industrie numérique est une économie des data, et elle fonctionne en traçant et ainsi en capturant l’activité des internautes à travers des systèmes de traçabilité extraordinairement développés. Evgeny Morozov s’est intéressé aux nouvelles automobiles qui sont désormais dotées de centaines de capteurs destinés à tracer les comportements des automobilistes en vue de nouveaux modèles d’assurance, de santé, etc. Michael Price a montré que les nouveaux téléviseurs sont eux aussi dotés de centaines de capteurs destinés à analyser le comportement du téléspectateur. Comme le dit Price, même Orwell ne l’aurait pas imaginé. Dès l’apparition des réseaux sociaux, Geert Lovink avait souligné la dangerosité de cette traçabilité généralisée. Facebook en particulier est un appareillage très pervers basé sur le mimétisme structurel qu’instaure « l’effet de réseau » – parce que l’autre y est, il faut que j’y aille aussi.
Cités : Est-ce que vous y voyez un risque « totalitaire », l’observateur, comme on pourrait l’appeler, possédant l’algorithme qui arbitre ce que l’usager reçoit de l’émission des personnes avec qui il est en relation, et inversement, parce qu’il voit d’abord ce que l’on émet ?
BS : Bien sûr. C’est « totalitaire », mais dans un sens très nouveau – et les réseaux sociaux pourraient être tout autres.
Les réseaux sociaux actuels reposent sur un mensonge technologique. Voici ce qu’ils disent à leurs membres : en tant que « crowd », vous constituez le « bottom up » (la base), et c’est à ce titre que vous êtes invités à « poster » toutes sortes de traces de votre comportement, mais vous êtes également, et par cela même, obligés de céder ces traces au gestionnaire propriétaire du tout. Or ce « bottom up » ne peut lui-même fonctionner qu’au service d’un système top down (dirigé par le sommet), qui exploite les données de façon structurellement occulte – parce qu’il est secret et protégé par la propriété industrielle. Tout se passe donc comme si le fonctionnement de cette société planétaire était délégué à quelques entreprises lui interdisant d’accéder à son propre fonctionnement. Cela n’avait jamais existé auparavant – même dans les églises les plus répressives.
Cependant, avec l’apparition il y a à peine huit ans des réseaux sociaux, eut lieu la prise de conscience du fait que le numérique est un pharmakon ayant d’extraordinaires potentialités de libération et d’ouverture, mais à condition seulement de définir des règles de conception et de fonctionnement des plateformes.
Le numérique est un pharmakon qui, tel un médicament, suppose une thérapeutique, laquelle ne peut pas être déléguée au fabriquant du « médicament ». Il en va ainsi avec les narcotrafiquants, et rien n’est plus destructeur. La thérapeutique est l’affaire de la politique, c’est-à-dire de tous les citoyens. Et ce sont les établissements d’enseignement et de recherche qui doivent le permettre – par la généralisation de ce que nous appelons la recherche contributive.
La technologie numérique est une forme de l’écriture, une écriture qui se produit à la vitesse de la lumière, par le truchement de machines auxquelles on délègue des processus de lecture et d’écriture organisés et contrôlés par un secteur industriel planétaire, fondé sur des entreprises de taille mondiale qui existent depuis très peu de temps. L’écriture et la lecture numériques constituent le nouveau milieu des savoirs : l’astrophysique, la nano-physique, la biologie, la géographie, l’histoire, les mathématiques, la linguistique, les sciences du sport même. Ainsi, tout, absolument tout, est en train de devenir numérique. On assiste à une mutation totale du savoir, qui concerne aussi les savoir-faire et les savoir-vivre. C’est la vie quotidienne qui s’en trouve d’abord bouleversée, dans toutes les dimensions de l’existence.
Or tout cela est instauré par le marché sans qu’il n’y ait l’ombre d’un processus critique susceptible d’apporter au moins des nuances et des inflexions. Il est inimaginable que l’université continue à suivre son petit bonhomme de chemin sans faire de cet objet son intérêt principal. C’est avec cette conviction que nous avons constitué le digital studies network qui regroupe des chercheurs et universitaires d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud, et d’Europe.
Bologne fut en 1088 la naissance de l’université européenne – issue d’un conflit entre l’empereur Frédéric Barberousse et le Pape. C’est dans le contexte de cette lutte que Barberousse donne aux clercs de l’université de Bologne un statut d’autonomie qui sera l’origine des universités européennes (Bologne, Oxford, la Sorbonne, puis Cambridge, Harvard, Berlin) et qui donnera à l’Europe sa suprématie pour longtemps.
À travers ses universités devenues autonomes, c’est-à-dire libérées des dogmes, il s’instaure en Europe une fonction critique qui, dans un Occident s’acheminant ainsi vers sa modernité, va devenir la fonction de base. C’est ce qui va conduire tout aussi bien à la mondialisation, qui ne commence évidemment pas avec le storytelling de l’idéologie néolibérale, et qui ne signifie pas la disparition des autorités locales.
Aujourd’hui se pose à nouveau la question d’une mise en réseau des institutions critiques par-delà les papautés et les empires de notre temps – Barberousse ne s’étant pas soumis les clercs mais leur ayant au contraire garanti l’autonomie qui, avec l’imprimerie, a conduit à la République des Lettres. La réticulation numérique rouvre ce type de question au moment où, plus que jamais, dans ce que l’on appelle désormais l’Anthropocène, nous avons absolument et urgemment besoin de reconstituer un pouvoir critique. Les universités et les organismes de recherche ont des arguments pour négocier leur participation à la formation du monde : sans eux, rien ne peut se faire. Et ce qui intéresse les meilleurs chercheurs, ce n’est pas l’argent : c’est le savoir. Plus que jamais notre monde est engendré par la libido sciendi – qui combat l’immonde, dont le nom est l’irrationnel : à notre époque de très hauts risques, la vénalité qui a épousé l’irrationalité menace le monde en totalité.
L’appareil académique réticulé a un très grand pouvoir, mais il l’ignore et n’en tire pas parti. Or il peut et doit intervenir sur le cours des choses s’il l’estime nécessaire dans tels et tels domaines. (pp.16-20)
(…) Il faut que les universités s’emparent du numérique : c’est pour elles une question de survie. L’université sera éditrice de savoirs ; elle ne sera pas seulement dispensatrice d’enseignement. Autrement dit, elle sera numérique ou elle ne sera plus. Toute la question des nouvelles industries éditoriales issues des activités éditoriales savantes se tient à l’horizon de ce changement. Pour l’accompagner, il faut que l’université exerce ses responsabilités politico-sociales – c’est-à-dire, évidemment, aussi économiques – de critique du devenir-numérique. (p. 22)
(…) Et on ne saurait déléguer le pilotage de l’énorme puissance qui se développe à travers le numérique à des actionnaires qui refusent la fonction critique. D’un point de vue systémique, l’Anthropocène est un problème d’entropie. Il ne faut pas compter sur Google ni sur Amazon pour en tirer les conséquences, vu que ce sont deux entreprises très hautement entropiques – c’est du moins ce que j’ai essayé de montrer dans La Société automatique 1. L’avenir du travail. (p.22)
(…) Pas encore. Aux États-Unis comme un peu partout dans le monde, on parle de Digital Humanities, où il s’agit surtout de mobiliser les capacités analytiques du calcul au service des sciences de l’homme et de la société, ce qui est évidemment indispensable. Mais les Digital Studies visent autre chose : elles examinent les conditions dans lesquelles les techniques en général et le numérique en particulier modifient les objets de savoir eux-mêmes. (p.26)
(…) Je suis un « natif de la télé » et mes étudiants le sont « du numérique » comme mon père était un natif de la radio, mon grand-père un natif du cinéma, mon arrière-grand-père un natif du journal quotidien, mon arrière-arrière-grand-père un natif de la gazette… Il n’y a rien de nouveau à cet égard dans ce que j’appelle la nativité technologique, qui fait le cerveau humain : le cerveau humain est sans arrêt en train d’intérioriser de nouveaux processus. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la massivité et la vitesse de transformation que le numérique a induites, et celles-ci sont beaucoup plus violentes que ce qui s’est produit par le passé, encore que la radio entre 1923 (elle commence en France en 1923) et 1939, ce qui ne fait jamais que seize petites années, a tout de même conquis 45 % des Français. 45 % de la population française a la radio en 1939, ce qui est déjà considérable, sachant que seize ans auparavant personne ne l’avait. Le bouleversement dans ce domaine n’est donc pas nouveau. Ce qui est nouveau se relie bien plutôt au fait que le caractère plurifonctionnel du numérique – à une plus grande vitesse que la radio tout de même – pénètre tout, qu’il va partout et qu’il ne s’occupe pas que de vos oreilles pour distribuer des programmes de radios : il s’occupe de tout en effectuant des calculs sur tout et ce faisant, en corrélant tout. Et cette totalité computationnelle a de quoi inquiéter ceux qui défendent la singularité, c’est-à-dire la néguentropie, c’est-à-dire l’avenir dans l’Anthropocène.
On nous dit que les jeunes gens savent faire toutes sortes de choses que nous ne savons pas faire. Il faudrait préciser ce qu’on appelle ici savoir. En vérité, ce qu’ils ont, ce sont des compétences, sur lesquelles ils ne possèdent généralement aucun savoir. Car un savoir, au sens où l’on transmet un savoir à l’université, ce n’est pas du tout cela. C’est tout d’abord avoir la capacité de resituer le savoir que l’on a dans une histoire de ce savoir qui le constitue précisément comme savoir. Les « natifs du numérique » sont de très bons récepteurs d’une ergonomie des interfaces homme/machine et d’un marketing extrêmement intelligent comme l’est en particulier celui d’Apple, mais ils n’en retirent en général aucun savoir à proprement parler, sauf bien sûr s’ils se mettent à étudier leurs pratiques, du point de vue de l’informatique, de la philosophie, des mathématiques, de l’ergonomie, etc.
Ces nouvelles générations, qui assument ces nouvelles compétences, sont évidemment porteuses d’un immense potentiel de savoirs encore inconnus. Depuis des années, je tente de cultiver ce potentiel (de le faire passer à l’acte) chez mes étudiants, qui sont du reste tels que je n’ai des choses à leur apprendre que parce que j’apprends beaucoup avec eux. (pp. 27-28)
Suite de la sélection d'extraits classée dans la section "Enseignement"
Ou retour à l’ensemble de cette sélection: